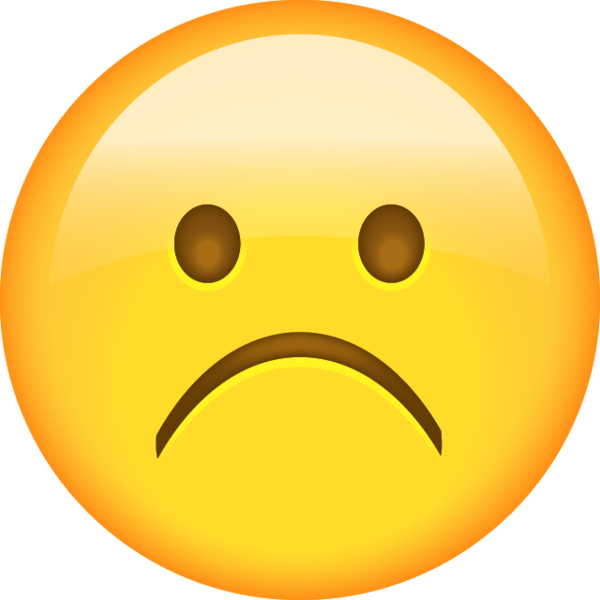Anthropotechnologie
Depuis 1990, Philippe Geslin contribue au développement de l’anthropotechnologie, un domaine de recherche en sciences sociales qui s’attache à la résolution des problèmes posés par l’arrivée de nouvelles technologies dans un environnement pour lequel elles n’étaient pas initialement conçues.
La cuisson de la saumure nécessite du bois comme combustible, Guinée, Afrique de l’Ouest, 1998 © Xavier Desmier
Les échecs en termes de transferts de technologies ne se comptent plus, y compris dans le contexte de la production alimentaire. Ces transferts ne sont souvent que de simples implémentations de systèmes techniques ne prenant pas en compte les réalités sociales ou culturelles du contexte de mise en œuvre. C’est cette analyse associée à des propositions de repères sociotechniques pour la conception que vise à produire l’anthropotechnologie1.
Un baroudeur rassembleur de cultures
Philippe Geslin est un ethnologue français. Après des études à la Sorbonne et à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, il soutient une thèse de doctorat en anthropologie sociale et ethnologie. Depuis 1990, il contribue au développement de l’anthropotechnologie à travers de nombreux terrains de recherches et d’intervention en Afrique, Asie, Amérique latine et Groenland. Selon sa propre définition, cette discipline « concentre ses actions sur l’étude et l’amélioration des conditions de travail et de vie des populations à travers le monde. Elle oriente les acteurs des processus de conception en les rendant attentifs au ‘facteur humain’, à ses composantes sociales, culturelles et environnementales. Elle valorise par conséquent une conception des techniques respectueuse des personnes, de leur manière de penser et d’agir dans des contextes spécifiques2.»
Sa première intervention en anthropotechnologie l’amène sur le littoral guinéen de 1993 à 1997, auprès de l’ethnie Soussou, qui produit traditionnellement du sel en faisant chauffer une saumure dans des bacs de chauffe alimentés par du bois de palétuvier. Les quantités de bois utilisés sont importantes, c’est pourquoi, pour enrayer la déforestation de la mangrove, un programme prévoit d’introduire un système alternatif de production de sel : celui des marais salants guérandais. L’ethnologue accompagnera les phases d’analyse, de conception et de test de ce transfert de technologie entre les paludiers de Guérande et les Soussous.
Interview
Philippe Geslin, comment êtes-vous venu à l’anthropotechnologie ?
« Venant de la technologie culturelle et de l'anthropologie des techniques, je me suis orienté vers l'anthropotechnologie parce que, dans les disciplines qui étaient les miennes, on n'a pas su, on a pas eu le temps ou on n'a pas voulu développer de méthodologie d'intervention. En tant qu’anthropologue des techniques, je m'interrogeais sur le rôle que je pouvais jouer dans les processus de conception ou de transfert de technologie. L'anthropotechnologie est un champ dédié aux processus de conception de techniques et de produits. C’est un champ de recherche appliquée qui intègre les manières de penser et d’agir des individus dans les processus de conception. Maintenant je suis dans une école d’ingénieur (Haute École Arc Ingénierie à Neuchâtel, ndla) où je dispense cette discipline. Je trouve que c’est intéressant de former ces jeunes qui seront un jour dans les entreprises et prendront des décisions en matière de transfert de technologies, de choix technologiques. »
Qu’est-ce qui caractérise l’approche anthropotechnologique ?
« L’anthropotechnologie part du terrain, c’est une approche longue et contraignante. Alain Wisner l’avait lancée en France dès les années 603. Il n’a toutefois jamais été en mesure de l’appliquer concrètement sur les projets. En s’inspirant de ses travaux, nous avons construit nos méthodologies de manière à ce qu’elles puissent s’intégrer dans des processus de transformation de situation et l’appliquons sur le terrain depuis 25 ans. Nous accompagnons des projets précis dans les domaines les plus différents en travaillant sur la totalité du processus. D’une manière générale, on travaille en réponse à des demandes. Bien évidemment, nous apportons des réponses techniques, mais l’être humain est toujours au cœur de la démarche. Il s’agit de contextualiser la demande, en prenant en compte les besoins des utilisateurs et des utilisatrices et en pensant aux répercussions des choix techniques sur les conditions de vie. »
Quelles sont les applications possibles de l’anthropotechnologie dans le domaine alimentaire ?
« Il y a plein de niveaux possibles. On peut travailler sur les processus de transformation des aliments. Analyser les pratiques culinaires pour la conception de nouveaux produits. Envisager par exemple ce que lesdits processus peuvent avoir comme influence sur de futurs choix techniques en matière de préparation des aliments : pertinence ou non du recours à un four solaire dans telle ou telle société, découpe grossière ou menue et son impact sur les choix de conception d’un robot culinaire destiné à l’exportation, etc. On peut aussi travailler sur les aspects sensoriels. Une des membres de notre équipe, Carole Baudin est d’ailleurs spécialisée en anthropologie du sensoriel avec des applications possibles sur les choix de matières, de textures, etc. Les Soussous par exemple considéraient le sel solaire comme plus salé que le sel produit localement. Ce fut un facteur déterminant dans le choix de l’innovation. Nous travaillons beaucoup sur les représentations à l’œuvre dans les choix techniques. Restons sur l’exemple des Soussous. Dans cette société, il y a deux genres de sel : le sel mâle et le sel femelle. Le premier est un médicament fabriqué à partir de la saumure chaude qui permet de produire le second destiné à la consommation quotidienne4. En privilégiant le système de production de sel solaire au détriment de la cuisson de la saumure, les populations ont délibérément fait le choix d’abandonner la production de sel mâle et d’abandonner de fait un des traits de leur tradition de saliculteurs. Dans toutes les sociétés à travers le monde, le goût, le toucher, la vue sont façonnés par la ‘culture’. »
Vous appliquez la démarche anthropotechnologique partout dans le monde. Comment cela s’est-t-il passé avec les producteurs de sel en Guinée ?
« Le projet en Guinée était spécifique car il n’émanait pas des populations locales mais des paludiers français de Guérande. Ils désiraient y transférer leur technique de production de sel – les marais salants – afin d'enrayer la déforestation de la mangrove, tout en veillant à ce que cette technologie réponde aux besoins des producteurs locaux Soussous.
Je suis resté quatorze mois sur le terrain. S’il est vrai que la saliculture traditionnelle consomme du bois, je me suis vite rendu compte que localement, les producteurs mettaient en œuvre des savoir-faire efficaces en matière de gestion du bois de palétuvier. Ils savaient gérer la ressource en bois de mangrove. De fait, il n’y avait pas de déforestation. Les problèmes étaient ailleurs. À l’époque, les Soussous avaient d’autres besoins : ils désiraient notamment améliorer leurs conditions de travail pour réduire la pénibilité des tâches - c'était très dur de produire du sel (température élevée devant les foyers de cuisson, moustiques très nombreux en mangrove, accès à l’eau difficile, isolement sur les campements, déscolarisation des enfants pendant 4 mois, etc.) - et mettre en place des technologies qui permettraient en parallèle de sécuriser leurs rizières, afin de garantir la production de riz.
Techniquement l’argile locale s’est révélée différente de celle de Guérande : elle n’était pas assez étanche et les marais salants donnaient un sel impropre à la consommation. La mise en place des marais salants se heurtait aussi à un système foncier complexe qui ne permettait pas à tous les producteurs de bénéficier de ce type d’aménagement. Plusieurs saliculteurs n’étaient pas propriétaires des terres, mais avaient uniquement un droit d’usage aux contours temporels incertains, sans l’assurance de pouvoir rester d’une année à l’autre sur les terres qu’ils utilisaient. Ce qui n’encourageait pas à investir dans des lourds travaux pour construire les marais salants.
La réalité du terrain était ainsi très éloignée de celle des paludiers de Guérande qui désiraient implémenter des marais salants de type guérandais sur la zone Soussou. Or, techniquement, économiquement et socialement, ça ne pouvait pas fonctionner. Mon rôle d'ethnologue a été de faire remonter ce qu’attendaient les producteurs Soussous, montrer les limites de l’exportation du système des marais salants guérandais lorsqu’on le ‘confronte’ aux réalités locales. Nous nous sommes ensuite lancés dans le processus de co-conception avec les futurs utilisateurs.»
En tant qu’ethnologue, avez-vous également étudié le rôle des représentations ?
« Absolument. Il faut se poser la question : « c'est quoi du sel pour les Soussous? ». Les Soussous produisent traditionnellement du sel en mélangeant de la terre salée avec de l’eau de mer afin d’obtenir une saumure. Celle-ci est par la suite chauffée dans des bacs jusqu’à ce que les cristaux de sel apparaissent. Les Soussous m'ont dit que le sel produit par les paludiers de Guérande n'était pas du sel à leurs yeux. Parce qu’il manquait ce qu'on appelle en ethnologie un catalyseur, c'est à dire qu'à leurs yeux, il manquait la terre salée qui permet pour un Soussou de faire du sel. Il a bien fallu à un moment donné concevoir une technologie qui permette de produire un aliment qui cadrait avec leur système de représentation. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons abandonné le système de marais salants guérandais et que nous nous sommes plutôt tournés vers un système de production sur bâches en plastique avec une production de saumure en amont, qui alliait à la fois l'eau salée et la terre salée. Tout simplement pour que cela fonctionne avec le système de représentation des Soussous. On se rend compte que, quelles que soient les technologies ou les produits fabriqués, si un produit ne rencontre pas un système de représentation en place il ne va pas fonctionner. Très souvent, l’importation de technologies - y compris de technologies alimentaires - capote pour des raisons purement symboliques et représentationnelles.»
La fabrication de sel sur bâche a été un succès ?
« Absolument ! Cette solution s’est révélée bien meilleure pour cette population que les marais salants de type guérandais. Les bâches en plastique sont connues, utilisées notamment en saison des pluies, bon marché et vite amorties. Le dispositif ne rencontre pas les problèmes du foncier car il est mobile et peut être rapidement installé ou déplacé d’un terrain à l’autre en cas de besoin. De plus, les bâches sont très faciles à utiliser : on verse la saumure dessus et, grâce à l’action du soleil et du vent, le sel cristallise en quelques heures, sans besoin de surveillance. Dans la mesure où les femmes n'ont plus à rester devant les foyers pour gérer les bacs de chauffe de cuisson de sel, elles peuvent passer du temps à fumer du poisson et le vendre sur les marchés tout en produisant du sel. Cela implique un accroissement de richesse pour les femmes. Certaines femmes ont même commencé à acheter des terres pour y construire des maisons qu’elles louent à des particuliers autour de Coyah.
Les hommes n’ont plus à couper du bois pour la production de sel. Ils restent dans les hameaux pour sécuriser les territoires de production du riz contre les remontées d’eau saline. La production de riz s’est considérablement accrue et le hameau de Wondewolia avec lequel nous avons travaillé est passé d'une centaine d'habitants en 1991 à 500 habitants aujourd’hui !
Cette nouvelle technologie a aussi profité aux enfants. Avec l’ancienne méthode de fabrication du sel, toute la famille partait quatre ou cinq mois sur les campements de production de sel. Maintenant que la production nécessite moins de force de travail, seules les femmes partent sur les sites de production. Les enfants eux restent dans le village avec leurs pères. Rester dans le village veut dire avoir accès à l’école. Cela a permis la scolarisation des enfants sur de plus longues périodes. Au final, cette petite bâche en plastique aura eu des répercussions absolument incroyables ! »