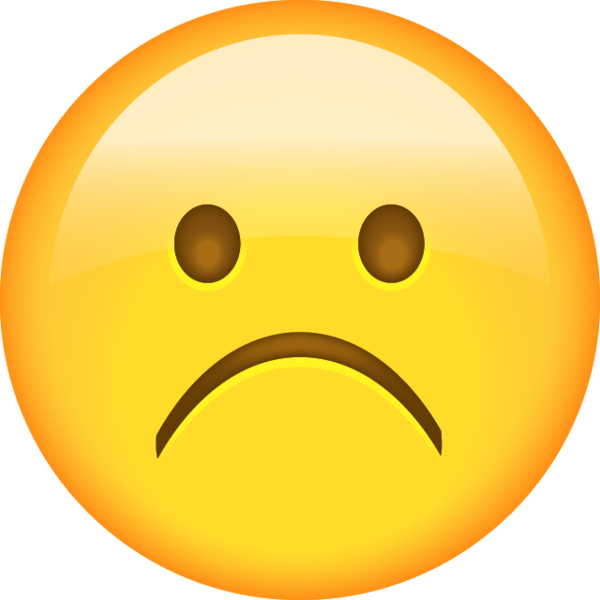Biberons de tous les temps
Exposée dans une seule et même vitrine jusqu’en août 2015 sur tout un pan de mur de l’Espace lait de l’Alimentarium, la collection de biberons du Professeur Rossi (1915 - 1998) propose un voyage dans le temps, de l’Antiquité à nos jours, à la découverte de l’alimentation des premiers mois de vie d’un nouvel être.
Quelques statuettes représentant une mère et son enfant, mais surtout un ensemble de biberons constituent l’essentiel de cette collection de pièces datées de l’Antiquité à la fin des années 60. C’est en 1998, au décès de son mari, que Valéria Rossi, consciente de l’intérêt scientifique des pièces, lègue l’ensemble à l’Alimentarium et vient complète une première série de biberons du XIXe et XXe siècle des collections du Musée de l’alimentation à Vevey.
Directeur de la clinique médicale Universitaire bernoise pour enfants de 1957 à 1985, Ettore Rossi a exercé une influence déterminante sur la pédiatrie suisse. Passionné d’histoire, ce professeur tessinois a regroupé de nombreuses informations sur les pratiques de soin et de l’alimentation des enfants de l’Antiquité à nos jours. Objets aussi beaux qu’insolites, ces biberons offrent une réflexion sur le statut de l’enfant et sur son alimentation à travers les siècles.
Allaitement maternel et substituts
Si le recours aux services d’une nourrice est attesté à Babylone au XVIIIe siècle avant J.-C., il devient la norme dans les classes aisées en Egypte ancienne, en Grèce et à Rome. Soranos d’Ephèse, médecin grec du IIe siècle après J.-C., décrit la nourrice idéale: «elle a entre 20 et 40 ans, elle est honnête, égale d’humeur, sympathique, elle jouit d’une bonne santé, elle a un bon teint, elle est de taille moyenne; son enfant a moins de deux mois, elle est propre et son lait n’est ni trop clair, ni trop épais.»(1) La nourrice était choisie avec soin, car on pensait qu’elle transmettait à l’enfant ses qualités, ou ses vices, par l’intermédiaire de son lait. Cette tendance, qu’elle ait pour origine des raisons culturelles, morales, ou médicales, d’abord limitée aux milieux urbains, se diffusera par la suite dans toutes les couches de la société entre le Xe et le XVIe siècle. A partir de l’époque moderne, toute l’Europe adoptera cette manière de faire: les nourrices sont appelées wet nurses en Angleterre, bala en Italie, nodriza ou ama au Portugal. On parle même en France d’une véritable «industrie nourricière» au XIXe siècle(2).
L’usage du biberon est lui aussi attesté dès l’Antiquité. Un papyrus égyptien datant du XVe siècle avant J.-C., mentionne la recommandation d’une boisson faite de «lait de vache et de grains de blés bouillis», sans doute si le lait maternel faisait défaut(3). Soranos fournit de nombreuses informations sur les méthodes d’alimentation du nourrisson de l’époque romaine. Le colostrum était notamment considéré comme nocif pour les enfants parce qu’il était épais et difficile à digérer. Il conseillait d’introduire dans le régime des aliments semi-solides tels que des miettes de pain trempées dans du lait, de l’hydromel ou du vin doux ou miellé dès l’âge de 6 mois, à l’apparition des dents, et, plus tard, «le potage de gruau, la purée très liquide, un œuf mollet»(4). Les textes d’Avicenne, médecin et philosophe perse, nous renseignent quant à eux sur les pratiques du Moyen-Age: il préconise d’allaiter l’enfant pendant deux ans, et de le sevrer petit à petit jusqu’à ce qu’il soit capable de manger toutes sortes de nourriture. Du lait d’animal, vache ou chèvre, ainsi que des bouillies claires de lait et de farine leur étaient souvent donnés dans des cornes ou récipients munis de tétines en drap(5).
L’allaitement artificiel prendra son plein essor à l’époque moderne, entre les XVIIIe et XIXe siècles, pour pallier au manque de nourrices, tant recherchées à cette époque. Ces dernières se chargent alors souvent de plusieurs nourrissons, élevés «au petit pot, à la bouillie ou à la soupe indigeste de la famille»(6). Dès le milieu du XIXe siècle, l’alimentation de substitution à base de lait animal - ânesse, brebis, chèvre ou vache - donné à l’enfant se développe en vue de lutter contre la mortalité infantile. Les découvertes de Pasteur, et les techniques de stérilisation des biberons qui en résultent, amélioreront considérablement les risques sanitaires de l’allaitement artificiel. L’emploi des biberons se généralise, d’abord sous des formes variées en étain, fer-blanc, faïence et porcelaine, puis les biberons en verre s’imposeront progressivement au début du XXe siècle.
Préhistoire
Si aucune représentation figurée ne montre l’allaitement au cours de la préhistoire, une très récente étude parue dans la revue Nature nous en apprend davantage. Les taux de barium analysés sur une molaire d’enfant de la période de Néandertal permettent d’envisager que les bébés auraient été allaités pendant 7 mois, puis supplémentés avec d’autres aliments durant les 7 mois suivants pour être complètement sevrés vers 18 mois(7). Ces résultats surprennent la communauté scientifique, car on sait que dans la nature, les femelles chimpanzés allaitent leurs petits pendant plus de 5 ans et que, d’après les parallèles ethnographiques, l’âge du sevrage dans les populations non industrialisées se situe vers l’âge de 2 ans et demi. Cette étude reposant sur l’analyse d’une seule dent fossile, elle ne permet toutefois pas d’en faire une généralité.
Antiquité
Les biberons antiques, qu’ils soient étrusques, hellénistiques ou romains, conservent une certaine homogénéité de formes sur une longue période de treize siècles, du IXe siècle av. J.-C. au IVe siècle ap. J.-C. Ressemblant à de petits vases à becs munis d’une anse et tenant dans la paume de la main, ils ont longtemps été sujets à controverse, considérés parfois comme des biberons, mais plus souvent comme des récipients destinés au remplissage des lampes à huile, ou pour ceux en verre, comme des fioles à parfums. Des résultats d’analyses effectuées dans les années 1990 sur des biberons en terre cuite et en verre confirment toutefois la présence d’acides gras saturés ne se trouvant que dans le lait humain ou animal (acides stéarique, myristique, laurique ou caprique), preuve que ces objets ont bien contenu du lait(8). Une expérimentation réalisée par une jeune mère a également montré que les récipients en céramique, de par leur forme et la présence d’une ouverture sur le haut, peuvent tout à fait avoir été utilisés comme tire-lait(9).
Les formes en terre cuite dotées d’un bec verseur et d’une anse latérale, s’apparentent à des versions miniatures des récipients de cuisine, cruches ou gobelets. Les «askoï» ont une ouverture décentrée et une anse sur le dessus, tandis que les biberons à filtre possèdent un couvercle percé de petits trous. De petite taille et de faible volume, ils tiennent dans la paume de la main et permettant de contenir de un à deux décilitres de liquide. Les «gutti» en verre font leur apparition au Ier siècle après J.-C. et se caractérisent par un bec très fin, utilisé pour verser le lait au compte-goutte. Souvent découverts dans des sépultures d’enfants inhumés en bas âge, ils témoignent d’une attention particulière pour ces petits défunts. Les inscriptions de stèles funéraires révèlent toute l’affection que les parents de l’époque romaine leur portent: ils se disent «très malheureux» de leur décès, ou parlent de «leur enfant chéri»(10).
Epoque moderne: l’apparition du biberon bouteille
Un tournant s’opère dans l’évolution des formes, lorsqu’au XVIe siècle, le biberon «bouteille» remplace les cornes de vache, les cruches et gobelets en terre cuite utilisés depuis l’Antiquité. L’importante mortalité des enfants abandonnés, placés en hospice et en nourrice, associée à la hantise de la dépopulation, incite les médecins à développer des techniques d’allaitement artificiel à base de lait animal. D’une grande variété de matières, les biberons présentent tous des caractéristiques communes: qu’ils soient en bois, étain ou verre, ce sont des récipients hauts, ressemblant à des bouteilles, complétés par un embout percé à faible débit, en forme de mamelon. Un tissu ou une petite éponge y était souvent placée pour éviter que l’enfant ne se blesse les gencives lors de la tétée. Les solides biberons en étain, malgré la forte mortalité qu’ils engendraient, ont été couramment utilisés jusqu’au XIXe siècle: le lait, «en s’acidifiant, finissait par attaquer et absorber le métal et devenait ainsi une cause d’intoxication grave pour l’enfant»(11).
Dès le XVIIIe siècle, les fabricants cherchent à améliorer le confort des nourrissons durant la tétée, tout en facilitant le nettoyage des récipients. Apparaît alors le biberon «limande», puis la «banane» anglo-saxonne en verre soufflé. Sa forme allongée permet au bébé de rester en position inclinée, et à la mère de réguler le débit du lait par pression du pouce sur un des orifices. La bouteille «sabot» se caractérise par un col relevé. Certains biberons présentent de magnifiques décors floraux gravés, témoignage du luxe et de la richesse des familles européennes aisées.
Les progrès industriels au service de la société de consommation
Entre 1850 et 1950, le biberon se plie aux exigences de la société moderne, qui réclame des produits résistants, pratiques et bon marché. Inventé en 1860, le biberon à tuyau répond à cette demande: cette flasque en verre dotée d’un tuyau en caoutchouc permet à l’enfant de se nourrir presque seul! Véritable nid bactériologique, ce «biberon tueur» d’abord plébiscité pour son côté pratique, est interdit en 1910. L’arrivée du verre moulé, en particulier du Pyrex® résistant à la chaleur dès 1924, offre ensuite des modèles de bouteilles droites et graduées, dotées de tétines en caoutchouc. Le goulot s’élargit progressivement pour garantir un nettoyage parfait. En parallèle, le développement de nouvelles disciplines médicales telles que la pédiatrie et la puériculture participent à la diversification de l’alimentation du nourrisson et de l’enfant en bas âge. C’est dans ce contexte que sont inventés la farine lactée et les premiers laits en poudre, développés en Suisse par Henri Nestlé et Maurice Guigoz.
Le merchandising d’après-guerre
Après la Seconde Guerre mondiale, de nouveaux matériaux apparaissent, comme la bakélite. Le fabricant français Remond utilise cette invention belge dès 1946 pour créer des bagues à vis qui permettent de fixer les tétines au goulot, sans les toucher. Dès les années 1960, la bague, le corps du biberon, mais aussi le protège-tétine récemment apparu sont en polypropylène. Les modèles se font désormais plus ludiques, grâce à des motifs imprimés en sérigraphie qui reprennent les personnages des dessins animés à la mode ou présentent le logo de la marque.
Le 21e siècle, au plus proche de l’allaitement maternel
Dès les années 1990, le biberon offre au bébé comme à la maman une expérience proche de celle de l’allaitement maternel au sein. La bouteille est en matériaux incassables et doux au toucher comme le plastique et le silicone. Elle participe au développement psychomoteur de l’enfant, avec une forme ergonomique en «S» ou des poignées ludiques. Les tétines s’adaptent aussi aux besoins de bébé: elles sont désormais en silicone, à plusieurs vitesses, anti-coliques, ou «imitation grain de peau». Du point de vue de la santé, la bouteille adopte un fond amovible hygiénique et se revendique «sans bisphénol A», un composé chimique présumé toxique. Point d’orgue de cette évolution, la machine à préparer des biberons grâce à des capsules de lait semble répondre aux besoins de notre société contemporaine.
D’après un texte de Cécile Lacharme publié dans La collection de biberons du Professeur Ettore Rossi. Pour une histoire de l’alimentation de l’enfant de l’Antiquité à nos jours, Alimentarium, 2004 et le catalogue d’exposition DEXTOX. Croyances autour de la nutrition, Alimentarium, 2014, enrichis et adaptés par Annabelle Peringer.